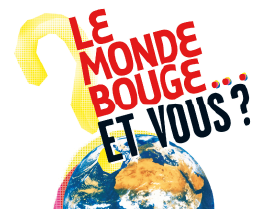Direction Antananarivo pour un huitième séjour depuis 2007. Impression première : année après année la situation se dégrade pour une très grande majorité de la population. Perception partagée par toutes les personnes rencontrées, chacune à son niveau :
- La survie en quotidienneté.
Le dernier rapport de la Banque Mondiale indique que 81% de la population malgache vit, en 2022, sous le seuil de pauvreté. 73,7% en 2017. Dans les villages on achète la tomate ou l’oignon à l’unité, voire l’huile ou le sucre à la cuillère, dans toutes les villes les cigarettes se vendent à l’unité, la recharge téléphonique sur le trottoir permet de passer une demi-douzaine de coups de fil…
Un habitant de Sambava : « ma voisine, qui a quelques biens (poste de télévision, chaîne hi-fi…), s’est faite cambriolée. On ne lui a rien volé de ses biens matériels, seuls ses sacs de riz ont été dérobés… »
Le salaire minimum est à 250.000 Ar, soit un peu moins de 55 €. L’association Amadea a mis en relation le prix de denrées de première nécessité, avec le niveau de vie en France :
- 1 kilo de sucre : 34,44 €
- 1 litre d’huile : 63,58 €
- 1 litre de lait : 19,88 €
- 1 kilo de carottes : 17,08 €
- 1 kilo de riz rouge : 22,12 €
- 1 litre d’essence : 33,88 €
- La corruption s’étend comme une maladie incurable.
La conférence épiscopale des évêques malgaches, dans un message du 14 mai, s’exprime sur le lien corruption – pauvreté : La corruption est une des causes de la pauvreté… Presque tous les secteurs sont touchés par la corruption et sous son emprise, même au sein de l’Eglise… Cela commence au niveau des responsables les plus proches de la population jusqu’à la plus haute sphère de l’Etat… Souvent il y a des personnes haut placées et bien fortunées derrière ces cas de corruption… Un système anti-corruption a été mis en place mais on ne sait pour qui ?
- Des infrastructures non entretenues
Liaison Antananarivo – Antsirabe par la nationale 7 : 160 km. Là où l’on mettait 2 h 30, voire 3 h les mauvais jours, actuellement de 4 h 30 à 5 h sont nécessaires vu son état où absence de revêtement, « nids d’autruche » et autres dégradations nécessitent de passer régulièrement la première, de chevaucher le bas-côté…
- Un délestage de chaque instant… et un coût aléatoire
Prime à l’électricité gérée par Jirama société d’Etat (criblée de dettes). Soit le délestage est quotidien « cela fait trois mois que nous avons un délestage de 18 h à 21 h, ensuite du courant durant 15 à 30 minutes et un nouveau délestage jusqu’à 10 h du matin… A la direction régionale des Finances, de l’Economie et de l’Emploi de Sambava , cela fait une semaine que nous n’avons pas d’électricité ».
Jirama gère également l’eau (selon l’Unicef seuls 5 % des ménages ont une source d’eau potable améliorée qui fournit de l’eau salubre accessible sur place. 18 % mettent plus de 1 h par jour pour aller chercher leur eau dont 3 % plus de 3 h), aussi le délestage est également la règle : le mois denier, cela a duré pendant trois jours ! (Nirina à Toamasina).
« Après les festivités -fin d’année, Pâques, fête nationale, etc.- où le pays est très éclairé (rues, lieux publics), la facture suivante, qui habituellement tourne autour de 50.000 Ar (11 €), monte à 100, 150, voire 200.000 Ar sans qu’on sache pour quoi, si ce n’est que Jirama a beaucoup dépensé et a besoin de beaucoup plus d’argent que d’ordinaire. » (Tiana).
- L’insécurité généralisée
La presse relate quasi quotidiennement attaques, meurtres, vols de bétail à grande échelle, kidnappings réalisés par des dahalos (historiquement dans le sud du pays, la pratique du vol d’un zébu était « un fait culturel » pour montrer la virilité de l’homme avant de se marier … transformé aujourd’hui en vol organisé et grand banditisme) où l’implication d’élus, de policiers ou militaires (ou anciens) est régulièrement pointée du doigt… Mais comme devant les tribunaux, celui qui possède le plus de moyens (financiers et relationnels) est certain de l’emporter…
Lors des trajet de nuit (fortement déconseillés) les taxis-brousse se regroupent en convoi afin de minimer le risque d’attaque…
- Des services de base défaillants
Dans les hôpitaux, toute intervention nécessite de payer au préalable le coût de l’intervention, d’acheter les médicaments… le bakchich offrant prioritairement l’intervention. Antsirabe (300.000 habitants), une famille recherche un fauteuil roulant suite à une intervention chirurgicale ; seule une congrégation religieuse en possède un…Ayant besoin d’un médicament courant, la pharmacie me propose le même produit que celui que j’achète d’ordinaire en France. Je le paie le triple, ce qui correspond à 30 % du salaire minimum dans le pays.
Sahondra est retraitée de l’éducation nationale, tout comme son mari elle a tenu à faire carrière uniquement dans le secteur public : durant toute notre carrière on a dû travailler le soir, le week-end et durant les vacances (vente de gâteaux, réalisation de broderie, etc.) sinon nos deux salaires ne permettaient pas d’assurer à manger à nos trois enfants. En pleur elle rajoute : la profession n’est pas reconnue, savez-vous qu’aujourd’hui un instituteur débute à 300.000 Ar (62 €) ?
Pour se rendre à son lycée situé dans un autre quartier de Toamasina Noémie est contrainte de prendre un transport. Le mois cher ? Le tuc-tuc. Mensuellement, cela correspond à 40 % du salaire de sa mère qui travaille à l’hôpital.
Mais…
- Un téléphérique est en cours de réalisation dans la capitale dont les premiers essais ont lieu en ce mois de juin. Fleuron voulu par le président de la République.
- Un magnifique stade de football de 40.000 places vient d’être construit à Antananarivo par les Chinois, mais il ne correspond pas aux normes et ne peut accueillir des matchs internationaux.
- Dans les villes, le métier en tête du hit-parade des recrutements se nomme vigile – gardien – agent de sécurité que l’on trouve devant tout magasin (la charge est parfois confiée à des militaires). Le second concerne le transport en cyclo-pousse (qui remplace progressivement le pousse-pousse dans quasiment toutes les villes). Les uns comme les autres sont loués à la journée par le conducteur. Revenu les jours riches en activité : 1 à 3 €, mais « certains jours nous sommes de notre poche car nous n’avons pas eu assez de clients ».
- Le président annonce une autoroute « chinoise » pour relier Antananarivo à Toamasina –port, capitale économique- alors que la nationale 2 qui unit ces deux ville n’a aucun entretien depuis nombre d’années ; les 350 km s’effectuent en moyenne en 11 h…
Dans son numéro fin 2022, la revue Politika intitule son éditorial : au revoir confiance, bonjour défiance.
« Comment résoudre un système à deux inconnues : d’une part faire en sorte que les citoyens aient confiance aux institutions et, de l’autre, faire en sorte que ces institutions servent de manière désintéressée et efficaces ces premières ?… Quand la confiance disparaît, la défiance progresse. Le phénomène ne date pas d’aujourd’hui dans les zones enclavées, l’État a disparu depuis belle lurette. Les dahalo sur le terrain ou dans les bureaux règnent en maîtres… La lutte contre la corruption, l’exemplarité des détenteurs de mandats publics, le renforcement de la participation citoyenne constitue, entre autres, des débuts de solutions. Cette crise de défiance n’est pas notre seule apanage, mais elle entraîne des conséquences dramatiques pour le pays et sa population.
Face à cette situation, des gens agissent avec courage, abnégation, souvent sans soutien politique, parfois avec des aides étrangères qui ne prennent pas en compte les réalités locales. Quelques exemples :
Coopérative Tsinjo :
Créée en 2015, composée de 86 groupements, en moyenne de 5 familles, elle rassemble des agriculteurs de la région d’Analamanga, à une cinquantaine de kilomètres au nord d’Antananarivo. En collaboration avec Amadea (association française), les 400 paysans ont développé une production de semences certifiées de riz et d’haricots. Puis ils ont élargi leur production en se chargeant de transformer et commercialiser une large variété de fruits : litchis, bananes, mangues, physalis, kakis, pommes, ananas, etc. Leur souhait serait de vendre à l’exportation (notamment le physalis). Une sécherie pour conserver les produits et diversifier la production et une petite huilerie artisanale étoffent son activité.
Action Education Madagascar
Le projet SANDRATRA repose sur l’insertion socioprofessionnelle et citoyenne de jeunes mères célibataires déscolarisées de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA), dans trois arrondissements (1er, 3ème et 4ème). Conçu sur trois cohortes de 300 femmes durant trois années, il repose sur un double niveau :
- L’insertion sociale et citoyenne de 900 jeunes mères célibataires déscolarisées de 15 à 29 ans (rejetées par l’école et la société, démunies avec leur(s) enfant(s), dans l’insécurité -viols, violences-, ayant des difficultés sociales)pour une intégration citoyenne dans leur quartier et leur insertion professionnelle en salariat ou en entreprenariat avec un revenu décent. L’accompagnement se conçoit à travers une prise en charge globale intégrant l’ensemble des éléments constituant la vie de la personne (son histoire, sa situation personnelle, son profil, ses difficultés sociales, ses compétences, son environnement, ses réseaux personnels…) par une prise en charge psychosociale, éducative et professionnelle.
- Le développement de la capacité de maîtrise d’ouvrage de la CUA en insertion sociale, professionnelle et citoyenne des jeunes vulnérables de façon plus générale. Il s’appuie notamment sur la mise en place d’un Laboratoire d’Innovation Sociale (LABIS) dans chaque arrondissement : Tiers-lieu numérique qui offre des services de proximité aux jeunes à travers quatre dimensions clés : l’accompagnement psychosocial, l’employabilité, l’engagement citoyen et la recherche-action.
A son terme, porté par la CUA, le projet doit se poursuivre à hauteur de 150 bénéficiaires.
Résultats de la 1ère cohorte : Sur les 300 femmes, 200 ont un emploi, placées en salariat : 158 crocheteuses, 7 femmes de ménage, 5 esthéticiennes, 7 machinistes, 12 dans le commerce, 3 serveuses, 3 « petites mains » agroalimentaires – vannerie…, 2 coiffeuses, 1 puéricultrice, 1 en call-center, 1 opératrice de saisie. 41 en auto-emploi (14 % de la cohorte). 25 en attente d’insertion (8%) 34 ont abandonné (11%).
Fafiala
Sur un financement américain, l’association Fafiala assure cette année le reboisement de 1.156 hectares (soit 2.578.000 plants) dans une région reculée au nord d’Ambatondrazaka, année 2 sur 5 du projet « restauration en essences autochtones pour un changement des paysages dans les bassins versants du lac Alaotra ». L’objectif est double : la reforestation du versant et l’arrêt de l’ensablement. Elle s’effectue en essences autochtones et arbres fruitiers (caféiers, orangers, manguiers, litchis, etc.).
Les plantations impliquèrent le recrutement de 2.500 personnes : « Il n’y a pas à proprement parlé de formation, mais une sensibilisation aux techniques de plantation, à l’agroforesterie. (Lantonirina Chef de mission)
« En amont nous cherchons à comprendre le mode de vie des habitants, leurs pratiques, les associations existantes (femmes, jeunes, comité lutte contre le feu, etc.). Sont également abordés (sensibilisation) le respect du travail réalisé, la protection et l’entretien nécessaires, l’arrêt des feux de brûlis et des feux de brousse fait par les éleveurs pour augmenter la surface de pâturage. Il est essentiel, au-delà de la plantation, que la population soit sensibilisée. On implique tous les acteurs locaux : associations de jeunes, de femmes, les écoles, les églises, les élus, les notables.
L’impact de l’activité économique est visuel : en fin d’opération de 400 à 500 maisons ont vu leur toit de chaume remplacé par de la tôle. Nous essayons de conscientiser les enfants sur la notion de « classe verte ». Nous souhaiterions que soit créée une pépinière sous forme d’une coopérative de femmes (qui s’impliquent davantage que les hommes) pour pérenniser le projet à moyen terme (Albert, responsable socio-organisationnel).
Le centre d’accueil Mirana Tsiky
Ce centre à Antsirabe, ouvert en 2002, dont le nom signifie « centre du sourire » accueille des enfants de 6 à 12 ans en placement judiciaire, décision prise suite à l’incarcération de leurs parents, de problèmes de mœurs, de maltraitance ou abandonnés dans la rue sans que l’on puisse retrouver leur famille. En ce moment, Ils sont 16, dont 7 sont scolarisés dans l’école primaire du quartier. 14 internes intégralement pris en charge par l’association et 2 externes plus âgés qui rentrent chez eux le soir.
Sous la responsabilité de Liva, assistante sociale qui vit sur place, les enfants sont responsabilisés, participent aux tâches ménagères et chacun dispose d’une petite parcelle de terrain pour apprendre à cultiver. Le centre est financé intégralement par Amadea, association française.
La spiruline y est cultivée culture (et vendue) ce qui permet d’en offrir en cure aux enfants. Depuis peu, un centre de formation professionnelle peut accueillir 30 stagiaires, prioritairement des mères-célibataires. Il organise des formations en couture, informatique et pâtisserie.
Avana Tsara
Cette association dont le nom signifie arc-en-ciel en malgache se situe dans le village de Fiadanana non loin de Betafo. Création d’un tourisme villageois, à l’initiative d’Iavantsoa, guide, avec l’appui de Virginie, également dans le tourisme. « Au début ce fut difficile car les personnes ne croyaient pas dans la réussite du projet. Tout surprenait, par exemple quand nous avons fait un lieu spécifique pour prendre la douche (avec seau car il n’y avait pas -et n’y a toujours pas- de l’eau courante), les personnes se moquaient. Maintenant toutes les familles du village en ont réalisé un chez elles. En répondant aux besoins de la population locale avec l’argent issue de l’accueil touristique la vie du village a changé avec pour point d’orgue lacréation d’une école primaire composée aujourd’hui de six classes(certains enseignants sont toujours rémunérés par les parents).
« Depuis que nous avons ouvert la sécurité s’est développée car chacun a compris qu’un village accueillant est une condition de réussite et donc d’enrichissement. Toutes nos embauches sont villageoises ».
L’hébergement est proche de celui des gîtes de montagne chez nous. Le lien avec l’environnement est majeur. « Nous sommes les acteurs du projet avec les villageois, c’est à nous de décider ce que nous voulons ce dont nous avons besoin. Il y a quelques années l’USAID a décidé de nous fournir en moustiquaires. Nous sommes une région froide et nous n’avons quasiment pas de cas de paludisme. Résultat les gens s’en sont servi en clôture de leur jardin ou en filet pour la pêche.
Ces initiatives, parmi de nombreuses autres, attestent des mobilisations locales, du savoir-faire et de la volonté d’habitants, au-delà d’une démarche de « survie ». Ils sont bien loin d’une élite de politiciens tournés uniquement vers la volonté de se maintenir au pouvoir pour s’enrichir dans un entre-soi.
De notre côté, nuls besoins de décider pour ces habitants qui vivent, selon leurs habitudes à des milliers de kilomètres. Leur demande ? Un soutien à leurs projets par un appui, sous différentes formes, pour les accompagner sur le chemin qu’ils se tracent en favorisant la satisfaction de leurs besoins. A nous de l’avoir en ligne de conduite pour cheminer avec eux.